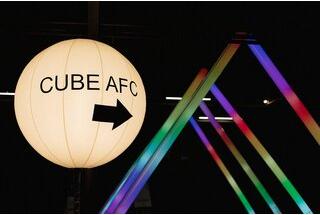Festival de Cannes 2024
Nadim Carlsen, DFF, nous parle du tournage de "Locust", de Keff
Par François ReumontPour mettre en image ce premier film, le jeune réalisateur taïwanais a fait appel au directeur de la photo danois Nadim Carlsen, DFF, dont le travail avait déjà été remarqué sur la Croisette (notamment avec le Holy Spider, de Ali Abbasi en 2022, pour lequel la comédienne iranienne Zar Amir Ebrahimi avait remporté le trophée de la meilleure interprétation féminine). Locust est sélectionné en compétition à la Semaine de la Critique 2024. (FR)
À Taïwan, Zhong-Han, un jeune homme mutique d’une vingtaine d’années, mène une double vie. Employé dans un restaurant familial le jour, il rackette en bande la nuit pour le compte de parrains locaux. Mais le rachat du restaurant par un homme d’affaires véreux met en danger ses proches, et oblige Zhong-Han à affronter son propre gang.
Qu’est-ce que représente ce premier film taïwanais pour vous ?
Nadim Carlsen : Outre que c’est mon premier film tourné là-bas, Locust se démarque pour moi, car c’est une des premières fois dans ma carrière où je dois reconnaître que chaque plan du film a été longuement mûri avec le réalisateur, et éclairé pas à pas. Une approche très différente, par exemple, de celle qui consiste à éclairer le lieu, et laisser beaucoup de liberté aux comédiens, la caméra s’adaptant à la situation. Sur Locust, tout est quasiment tourné soit sur trépied, soit sur Dolly, ou encore au Steadicam, avec autant d’attention sur chaque cadrage, et beaucoup de discussions en amont avec le réalisateur, Keff, qui est quelqu’un d’extrêmement sensible à l’image, aux ambiances et au découpage. Une expérience vraiment nouvelle pour moi, que j’ai pu partager avec mon chef électro Martin Lerche, qui était le seul européen avec moi dans cette aventure. Une personne extrêmement importante qui m’accompagne déjà depuis trois longs métrages. Je pense qu’on a apporté tous les deux une certaine sensibilité européenne à ce projet très ancré dans la vie et les enjeux taïwanais, et j’espère à la suite de sa présentation que cette histoire va toucher tous les spectateurs, en tout cas c’est dans cette direction qu’on a essayée de faire le film.
Aviez-vous des références, et êtes-vous familiers avec le cinéma taïwanais ?
ND : On a regardé avec Keff beaucoup de films de la région... Parmi lesquels ceux de Hou Siao Sien, comme Millennium Mambo et aussi Vive l’amour, de Tsai Ming Liang. Je me souviens aussi de films de Edward Yang, notamment pour la dimension épique de son cinéma dans lequel Keff voulait un peu inscrire l’aspect sociétal de son film. Visuellement, Wong Kar Waï aussi nous a guidé, avec un de ses premiers films (Fallen Angels, en 1994. Ce qui est certain, c’est que Keff voulait faire une sorte de déclaration politique avec ce film et prendre son temps. Le scénario était, je me souviens, assez long et le premier montage du film beaucoup plus long que la version envoyée à Cannes. Pour un premier film, une démarche assez courageuse, et très éloignée du simple drame à deux personnages dans un lieu unique qu’on peut imaginer dans de telles circonstances. Montrer Taïwan, parler des problèmes, des riches, des pauvres, de la violence... sans se brider et sans se presser !

Une des particularités du film, c’est de proposer l’histoire d’un personnage principal muet...
ND : Oui, ce n’est pas anodin de proposer le portrait d’un protagoniste incapable de parler...
Mais je vais vous dire, à la lecture du scénario, ça ne m’a absolument pas sauté aux yeux ni gêné. Au contraire, l’écriture de Keff était si limpide que pas une minute on s’arrêtait pour se poser cette question. Et tout l’enjeu reposait en fait sur l’empathie que peut avoir le spectateur avec lui, et toute la galerie de personnages secondaires qui lui servent tour à tour de miroir pour pouvoir exprimer ce qu’il ne peut dire. À aucune étape de la fabrication du film je ne me suis dit que ça allait être difficile de s’identifier à ce personnage, bien au contraire. Je ressentais ses émotions, je voyais très bien où il allait, et ça n’engendrait aucune restriction en termes de cinéma à proprement parler. Sur le plateau, je pense simplement que notre jeune comédien Liu Wei Chen a trouvé cette manière de rester à la fois énigmatique, tout en transmettant généreusement ses émotions à la caméra, et en s’appuyant sur tous les autres personnages pour qu’on comprenne la solitude et le dilemme auquel il est confronté. Et je pense aussi que cette idée de personnage muet aide beaucoup au propos de Keff. Proposer une histoire à la fois très ancrée dans une vie locale, des coutumes... et pourtant la rendre aussi très universelle. En termes de découpage, et de travail à la caméra, son silence nous a poussés à inclure plus de mouvements quand on est avec lui. La caméra le suit, ou le décrit, se rapproche parfois... Une manière, par exemple quand il envoie ses textos, de renforcer la connexion émotionnelle avec lui. De le rendre particulier, plus proche encore du spectateur.
Autre scène qui me vient à l’esprit, ces longs plans nocturnes sur lui dans la séquence à l’arrière de la camionnette, quand il accompagne ses comparses vers leur expédition punitive. Le trajet terminé, on reste avec lui à sa sortie du véhicule, de dos, en reculant tandis que les autres s’élancent vers leur mission cruelle. Je crois que c’est une séquence où sans un mot et lui en silhouette comprend pourtant tout ce qui se bouscule dans sa tête.
Aimez-vous les surprises ou l’inattendu sur un plateau ?
ND : Moi je suis quelqu’un qui prépare énormément, s’appuie beaucoup sur les repérages et les discussions avec le metteur en scène. Pourtant, une fois le tournage lancé, rien ne se passe exactement comme prévu. Il faut alors savoir faire confiance à son instinct, et surtout rester curieux de tout. Une manière de continuer à questionner les choix qu’on a pu faire en préproduction, et de capturer quelque chose d’unique. C’est un peu là toute l’ambiguïté du travail de caméra sur un film, à la fois être capable de planifier, et aussi s’adapter à ce qui peut se passer. Le tout en essayant de garder toujours à l’esprit la direction donnée au départ. C’est cet ancrage artistique qu’il faut tenir, notamment face à l’écueil des fausses bonnes idées de dernière minute qui attirent trop l’attention, ou qui transmettent soudain quelque chose de trop appuyé pour le film.
Le film est aussi construit entre le jour et la nuit, comme le personnage et sa double vie...
ND : Les scènes de jour et les scènes de nuit traduisent effectivement cette double personnalité.
Et filmer une telle histoire à Taipei, c’est une vraie bénédiction. Les ambiances nocturnes là-bas sont immédiatement très cinématographiques, avec énormément de lumières dans la ville, d’effets, de lueurs en arrière-plan... C’est vraiment splendide. En plus, le climat est souvent humide, et ça vous donne tout de suite des brillances sur les trottoirs ou les rues sans rien avoir à faire. Même si la corruption, et l’affairisme n’attend pas la nuit pour se montrer, je pense que c’était assez important de mettre en place visuellement ce contraste entre des séquences très normales de jour, avec son travail quotidien dans ce petit restaurant de quartier, le magasin où il va faire ses courses, la fille dont il tombe amoureux... des choses très communes à la plupart des gens en fait. Et puis, quand la nuit tombe, une version beaucoup plus inquiétante de la ville, un peu comme si on creusait sous la surface, avec des lieux qui ont leurs codes, leur clientèle. Un monde où les femmes, la célébrité, l’argent deviennent tout d’un coup omniprésents. Avec l’idée de montrer que notre personnage se retrouve complètement écartelé entre ces deux mondes qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Cette première plongée dans la nuit, c’est la séquence de la boîte de nuit...
ND : Dans le scénario, c’est le genre de séquence qui est très factuelle. Du style : « Il rentre dans la boîte, descend les marches, et il danse au milieu d’autres personnes ». Très difficile d’imaginer ce que ça peut donner sans avoir visité le lieu, ou même finalement tourner la scène. Et je dois avouer combien j’ai été surpris par l’émotion qui m’a gagné sur place à l’œilleton de la caméra. Soudain, l’intensité viscérale de la musique, la manière dont les gens dansent, et ce côté stroboscopique de la lumière qu’on a installée m’a fait absolument comprendre le sens profond de cette scène, à savoir la première fois où on se retrouve seul avec notre personnage, au milieu d’une foule de gens tous solitaires qui dansent seuls. Cette notion d’être complètement isolé dans une foule me semble être l’expression visuelle parfaite à la fois de son infirmité, et de sa vie personnelle. Une scène très viscérale, avec la combinaison du son et de l’image, qui doit avoir beaucoup d’impact en salle dans ce début de film.
La séquence du braquage de l’influenceur est aussi très particulière, avec un jeu frénétique sur les couleurs...
ND : Pour cette séquence, c’est encore le lieu qui détermine la lumière. Avec cet énorme écran sur lequel tournent des boucles d’images de bandes lumineuses, avec un côté très irréel dans l’ambiance. Même les tables de ce club sont équipées de bandes LED dont on pouvait faire changer les couleurs.
Il y a un côté chaotique dans cette scène amené par la lumière, mais un chaos bien ordonné à l’image, grâce à la programmation qu’on a mise en place avec mon chef électro. En sélectionnant les couleurs qu’on voulait garder, et celles qu’on voulait mettre de coté. Ensuite, c’est un aller-retour entre la mise en place de la scène avec les comédiens, et ce qui peut se passer avec ces variations incessantes. Pas vraiment besoin de tout contrôler, une fois les choses lancées, ces boucles de lumière donnent beaucoup de dynamisme à la scène, alors qu’en fait c’est plutôt une scénographie très statique entre un groupe assis dans un canapé et deux braqueurs debout qui les menacent avec ces masques de Barrack Obama et Hillary Clinton...
Vous savez, c’est le genre de scène un peu joker à l’échelle d’un film. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de décor deux fois de suite. C’est un one shot ! Ça me fait vous dire aussi combien c’est important pour moi dans un film que chaque scène ait sa propre identité claire, une sorte d’ADN. Et par-dessus tout que vous ne soyez pas capables de deviner quelle sera la suivante. Et je pense qu’on arrive parfois à ça sur Locust...
Que retenez-vous de cette expérience ?
ND : J’ai adoré travailler avec ce réalisateur, qui n’a pas peur de prendre son temps, de mettre un peu parfois l’intrigue de côté pour s’égarer dans des séquences complètement annexes, parfois même humoristiques ou étranges. Des moments qui nous permettent de mieux comprendre les personnages, les rendent beaucoup plus complexes, ou simplement nous surprendre... Comme je l’évoquais, pour éviter de mettre le film sur des rails. Au montage, aidé par les choix décisifs de Mathieu Laclau, Keff a souvent osé prendre ce temps... Faisant durer les plans larges, ou certaines situations pourtant dénuées d’intérêt direct par rapport à la situation. Ça c’est une chose très précieuse, qui me surprend, et qui rend ce film si particulier pour moi.
(Propos recueillis par François Reumont pour l’AFC)
 En
En Fr
Fr