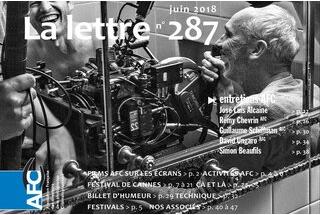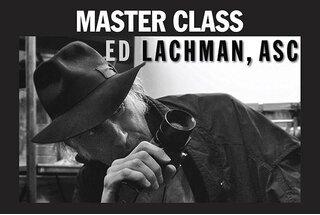Le directeur de la photographie Eric Gautier, AFC, parle de son travail sur "On the Road" de Walter Salles

Tu as choisi, pour ce " road movie ", la Penelope de chez Aaton en 2,35:1, pourquoi ?
Eric Gautier : C’est le cinquième long métrage que je tourne avec cette caméra. Elle est devenue ma caméra de prédilection. La Penlope est très compacte, assez légère, facile à attraper par sa poignée sur le dessus, et ses deux batteries enfichables sont efficaces. Donc pas besoin de câble.
J’aime travailler avec une caméra la plus dépouillée possible, avec le minimum d’accessoires… en fait avec juste le retour vidéo HF. Walter Salles suivait l’image avec un petit écran qu’il tenait à la main.
On était donc très souples, très réactifs, et très peu encombrants. Cette caméra est super légère et tellement intelligemment pensée, elle s’est imposée comme la caméra idéale pour ce genre de tournage très léger. Walter voulait utiliser le format 2,35, associé à des focales un peu longues, puisque l’humain compte plus dans cette histoire que les paysages.
Nous avons tourné beaucoup caméra à l’épaule, et ce format permet d’accrocher très facilement un autre acteur bord cadre ou en amorce et de relancer la dynamique du plan en recadrant un nouveau personnage. Nous avons tourné sur le mode documentaire, du moins en donnant l’impression de beaucoup d’improvisation et de liberté, un peu comme Cassavetes avec Shadows, qui était une de nos références de départ.

J’avais envie aussi de sentir la matière du film, la texture et le grain de la pellicule. Et le format 2,35 sur 2 perfos avait l’avantage de travailler dans cette direction, puisque l’image impressionnée est un peu plus petite que celle du Super 35 mm, 2,35:1.
Bien entendu, il y a aussi l’avantage économique, et des magasins qui durent plus longtemps.
Les personnages de On the road sont dans leur propre monde, hors de la " vraie vie ", transportés par leurs propres addictions (drogue, alcool, sexe, ivresse des conversations toute la nuit, fatigue) et ne regardent la vie que dans une vision étroite, comme s’ils avaient des œillères, droit devant eux, avec beaucoup d’énergie. Kerouac est un peu l’anti-Balzac, il décrit très peu les mondes qu’il traverse, il est direct, va à l’essentiel, d’où une grande difficulté à l’adapter. Je pense que le côté " étriqué " du 2 perfos et les focales longues vont dans ce sens.
J’ai donc fait l’inverse de ce que j’ai fait sur le film de Resnais, Vous n’avez encore rien vu, c’est-à-dire une image qui soit toujours un peu claustrophobe, une caméra qui colle aux personnages.
Toutes ces expériences existentielles et sensorielles servent à nourrir la littérature, même si Kerouac a aussi beaucoup inventé et affabulé.
Le tournage a duré très longtemps, dans plusieurs pays…
EG : Oui, il y a eu six mois de tournage, dans des pays différents, le Canada et Montréal tout d’abord, puis l’Argentine pour y trouver la neige en plein mois d’août, puis la Louisiane, l’Arizona, le Mexique, Calgary et Montréal à nouveau pour l’automne et le début de l’hiver, pour terminer à San Francisco. Les contraintes de casting et de tournage dans différents pays ont engendré un plan de travail tel que nous avons tourné les scènes dans le plus parfait désordre. L’exacte inverse de Carnets de voyages que nous avions tourné chronologiquement, en suivant la route exacte des deux protagonistes, les deux acteurs principaux étant avec nous tous les jours.
Je me suis ainsi retrouvé à raccorder souvent des plans d’une même séquence à 2 ou 3 mois d’intervalle, et à imaginer tout le temps ce qui précède ou suit la scène du jour. Comme c’est MK2 qui a financé le film, la postproduction s’est déroulée à Paris, chez Digimage. Le négatif était développé sur place, dans tous les lieux où nous sommes passés, puis le télécinéma avait lieu à Paris.
J’ai demandé à l’étalonneur des rushes de m’envoyer par mail des photogrammes de chaque scène, que je classais par séquence, dans l’ordre du scénario. Cette méthode m’a beaucoup aidé à assembler le " puzzle " du film. Et elle a été aussi très utile à Walter, ainsi qu’à Sam Riley, l’acteur principal. Cela nous a permis de mieux imaginer l’évolution de l’histoire, qui se passe sur 3 ans.
On a suivi la structure du roman, qui est une suite de scènes, de rencontres et d’expériences, un peu sous la forme feuilletonnesque. Bien sûr, le point de départ est la fascination de Sal Paradise (Sam Riley) pour Dean Morriarty (Garrett Hedlung). Ces personnages ne tiennent pas en place, on est toujours dans le mouvement, dans l’énergie. C’est ce que j’ai essayé de traduire avec beaucoup d’effets de surprises entre les scènes et les lieux, dans des effets de lumière et d’ambiances différents et dans le filmage avec la caméra.
Avec Walter, on s’était dit que ce qui était important pour ce film, c’était de faire ressentir les sensations des personnages, le chaud, le froid, l’inquiétude, le malaise, la joie ; par exemple, il était inenvisageable de tourner avec de la fausse neige en été, et prétendre que c’était l’hiver. Il fallait vraiment que les visages soient violets, que la buée sorte de la bouche, et que les comédiens soient frigorifiés dans la voiture. Le but était qu’à la fin du film, on ait l’impression d’avoir beaucoup voyagé, traversé beaucoup de lieux et les différentes saisons, rencontré beaucoup de personnages. Et que les sentiments et les relations des protagonistes aient évolué aussi.
Qu’est-ce qui t’a fait opter pour un film très coloré ?
EG : Cela aurait été une facilité de choisir de faire ce film en noir et blanc, ou avec des couleurs désaturées, pour illustrer les années 1949-51. Ça m’ennuyait d’avance… Je me suis dit que les années 1950, c’est le Technicolor, le début des grands photographes américains de la couleur…
Comme le négatif impressionné est assez petit, le rendu des couleurs n’est pas très riche, ça n’a rien à voir avec la finesse du rendu en Scope anamorphique. Cela m’intéressait, car je ne voulais pas être trop naturaliste. J’ai travaillé avec un très fort contraste des couleurs, et j’ai beaucoup utilisé des filtres, des cyan, des jaune-doré, pour renforcer les couleurs, ou pour les dénaturer en les compensant à l’étalonnage.
L’image est très brillante aussi…
EG : Oui, très contrastée. J’aime travailler le contraste, les lumières trop " claquantes " et les noirs " bouchés ".


C’est d’ailleurs essentiellement pour cette raison que je n’arrive pas à aimer le numérique, qui oblige à rester raisonnable, à contenir les hautes lumières, et à décoller les noirs et rendre tous les détails lisibles. Mais je suis devenu depuis quelques années un fervent partisan de l’étalonnage numérique, qui me permet de travailler très subtilement un négatif que j’ai " torturé " par l’exposition, le développement ou le rendu colorimétrique… Je trouve que la mixité des technologies est toujours enrichissante.
Tu as changé d’équipe dans chaque pays ?
EG : Oui, j’aime beaucoup tourner à l’étranger avec les équipes locales. Seul le matériel caméra nous suivait, la Penelope étant pour moi l’élément clé du film.

On a beaucoup tourné dans les voitures, beaucoup de choses improvisées aussi, beaucoup de plans à la main ; j’ai utilisé la série Zeiss standard. J’aime bien cette série assez vieille, elle est très compacte, très moyenne aussi en traitement de surface à côté des optiques modernes ! Donc idéale pour travailler les " flare " et rendre l’image vivante.

On a beaucoup tourné des intérieurs voiture, surtout avec la fameuse Hudson. Je voulais toujours garder cette idée de liberté et de rapidité. Il n’y a aucune voiture tractée, les acteurs conduisaient vraiment, et je pense que cela les a aidés à jouer, tout est filmé à la main, sans lumière additionnelle, en lumière naturelle…
J’avais fait fabriquer des filtres de densité neutre pour chaque fenêtre, des densités neutres rigides, que je plaçais sur les fenêtres dans le champ. Les autres fenêtres hors champs, sans filtre, suffisaient à faire entrer la lumière nécessaire pour équilibrer l’exposition. Et parfois, je ne rééquilibrais pas du tout, dans le désert en Arizona par exemple, où les fenêtres étaient grandes ouvertes. Je laissais brûler l’extérieur.

Avec les pellicules modernes, que ce soient des Kodak ou des Fuji, la surexposition est très belle, on sent les détails, les couleurs, et on ressent le soleil écrasant. En laissant les comédiens transpirer et leurs visages en sueur, on perçoit cette chaleur…
Mais il y a aussi beaucoup de nuits et de bars enfumés dans On the Road, on passe des rues peu éclairées de Denver à New York où c’est beaucoup plus lumineux. Tous les jours je prenais des partis pris de lumière différents, tout en me disant quand même que c’était pour le même film ! Et toujours un peu sur le fil du rasoir.
(Propos recueillis par Brigitte Barbier pour l’AFC)
 En
En
 Fr
Fr