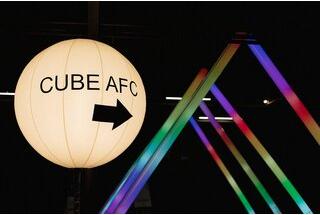Le directeur de la photo Pierre Maïllis-Laval interviewé par Panavision France pour le tournage d’"Anti-Squat", de Nicolas Silhol
Comment avez-vous été impliqué dans le projet ?
Pierre Maïllis-Laval : Je connais le réalisateur Nicolas Silhol depuis plus de vingt ans, nous avons fait La Fémis ensemble, lui en section Scénario, et moi en Image. De là est née notre relation professionnelle, et même notre amitié. J’ai été son cadreur sur ses courts et moyens métrages après notre sortie de l’école.
Comment décririez-vous le look du projet ? Y a-t-il des références visuelles particulières qui vous ont inspiré ?
PML : Anti-Squat est un film à la fois social et politique, avec une touche de thriller, qui nous parle du présent et qui a aussi vocation à nous alerter sur l’avenir. Le souhait de Nicolas Silhol était un traitement qui ne soit pas strictement naturaliste, d’avoir des choix d’image qui confèrent une dimension un peu dystopique au récit, avec quelque chose de déshumanisé et de futuriste. De lui donner les dimensions d’une fable sombre et anxiogène, je dirais vénéneuse. Quand nous avons travaillé en amont le look du projet et envisagé le traitement de la lumière et les enjeux de mise en scène pour la conception du découpage, Nicolas a insisté particulièrement sur trois références cinématographiques qui l’obsédaient : Les Bruits de Recife, de Kleber Mendonça Filho, Baccalauréat, de Chrsitian Mungiu, et Faute d’amour, d’Andrey Svyagintsev.
De façon plus personnelle, je trouvais que l’esthétique d’un film comme Nightcall, de Dan Gilroy, pouvait être intéressante et cohérente pour le projet de Nicolas. Les caractéristiques esthétiques d’Anti-Squat sont donc une image froide mais colorée, avec une volonté de jouer des contrastes chromatiques, de garder des dominantes marquées - et même un peu aberrantes - et des noirs profonds, presque brillants. Les décors étant pour l’essentiel un immeuble de bureaux, fait de blanc et de verre, avec des horizontales et des verticales omniprésentes, le défi était donc d’insuffler des touches d’étrangeté et d’irréel dans un univers très prosaïque.

Parlez-nous de la lumière…
PML : Pour les extérieurs, les lumières de l’hiver nous ont aidés : avec un soleil bas, des repérages, et un plan de travail précis, nous avons réussi à garder de la couleur, même sur les extérieurs jour, avec par exemple des aubes bleutées, des crépuscules aux teintes fuchsia, des fins d’après-midi dorées, tout en gardant quelque chose de sombre, de triste, un peu glauque. Pour les intérieurs, que ce soit en jour ou en nuit - ces dernières constituant une bonne part du film - nous avons travaillé à mettre en place des effets de lumière déréalisant comme des contre-jours marqués, à perdre les fonds, à ne pas toujours justifier les sources, à ne pas avoir peur d’une certaine densité.
A ce propos, Louise Bourgoin me taquinait car je refusais souvent de déboucher son visage et ses yeux, à faire briller son regard. En effet je voulais la marquer physiquement, ce qui n’est pas facile car elle est tellement lumineuse - solaire même - et sa peau si parfaite ! Et lui donner un regard de louve, profond et insaisissable, avec quelque chose de l’ordre de la statuaire antique. Le film se déroule beaucoup de nuit, et l’histoire en elle-même regorge d’effets lumineux (allumages, extinctions, lampe torches, etc.) comme si la lumière elle-même était un enjeu dramaturgique, dès le scénario.

Et du cadre…
PML : Pour le découpage, Nicolas voulait un film cadré plutôt large, que les personnages soient toujours inscrits dans l’espace, comme incrustés dans les lieux, et même asservis à eux, comme prisonniers d’un environnement. Il voulait éviter le plus possible les plans serrés, s’interdisait au maximum les gros plans. Le cadre était lui-même une réflexion sur la déshumanisation. Il y avait aussi une dimension scénique dans sa recherche de mise en scène : faire vivre le groupe dans un plan fixe et large, comme une scène de théâtre - dont Nicolas est un grand amateur et un grand connaisseur -, limiter au strict minimum les champs/contre-champs dans l’axe, et utiliser le Scope comme espace de la confrontation et de la conflictualité, avec par exemple un leitmotiv des profils en face-à-face.
Enfin, un autre aspect de sa démarche de mise en scène a été de tourner de nombreuses séquences en plans-séquences élaborés, même si beaucoup de coupes ont finalement été faites au montage. Nous avons, par exemple, fait plusieurs prises d’un long plan-séquence tourné à l’épaule - le seul du film, tous les autres étant opérés avec un système de stabilisation - en courant, en dévalant quatre étages, avec des bagarres dans les couloirs, qui finalement est monté très "cut", chaque plan gardant une part de ce chaos, et la vérité d’une scène pas découpée au tournage.

Et les outils ?
PML : En ce qui concerne la caméra, nous avons tourné avec la Sony Venice II, car ayant beaucoup de plans au StabOne, nous avions besoin d’une config légère et compacte, ce que nous offrait le système Rialto.
Par ailleurs le rendu possiblement plus sharp et un peu "métallique" de la Sony (comparé à l’Alexa par exemple) m’intéressait beaucoup dans la logique et la cohérence esthétique du film. De plus, le bâtiment tout en transparence nous mettait à la merci de découvertes difficiles à gérer alors que beaucoup de séquences étaient de nuit, j’ai donc beaucoup joué de la logique et du système Dual Base ISO de la Venice. La réponse de la caméra dans les hautes lumières m’a satisfait alors qu’avec sa grande sensibilité je la trouve très bien dans sa restitution des détails dans le pied de courbe. Pour ce qui est de l’optique, avec un film conçu surtout en plans plutôt larges, avec des focales plutôt courtes - mais le 40 mm est resté largement majoritaire -, tourné dans ce décor tout en verticales et en horizontales, avec des fuyantes et des cadres dans le cadre, j’ai voulu tourner avec les optiques anamorphiques Zeiss Master Prime.
Ces optiques m’offraient la plus grande précision dans le respect des lignes droites. Je voulais absolument éviter toute distorsion, toute aberration optique, si minime soit-elle. Toujours dans cette logique de déshumanisation, pour avoir un rendu optique qui n’ait rien d’organique. Et leur côté un peu "sharp" ne me dérangeait pas car ce piqué allait dans le sens d’une image un peu clinique. Bon, je les ai quand même filtrées avec une série Black Satin.
J’avais fait des tests en amont et j’ai adoré les Black Satin, qui donnent un look un peu brillant, avec un bel effet sur les noirs, et évidemment sur les sources dans le champ. J’avais demandé à Louise s’il y avait des filtres qu’elle appréciait particulièrement, et il se trouve qu’elle m’a justement parlé de cette série. J’ai vu un signe dans la concordance de ses envies et de mes tests préalables : c’était vraiment les filtres qu’il nous fallait.
Enfin, pour ce qui était des plans-séquences, j’ai voulu les opérer au StabOne. Le budget du film ne nous permettait pas de nous assurer les services d’un cadreur Steadicam, alors qu’il y avait beaucoup de plans-séquences, je les ai donc opérés moi-même avec un outil que je connaissais bien. En effet, j’avais tourné avec le StabOne pour Les Survivants, de Guillaume Renusson. Après avoir opéré dans 40 cm de poudreuse et par -10 °C, j’avais pu me rendre compte de la fiabilité de cette machine, dont j’apprécie certaines fonctionnalités et aussi la compacité - qui nous a permis, par exemple, de tourner des plans dans un car en la fixant sur un travelling et en la contrôlant avec une remote.

Qu’est-ce qui vous a amené chez Panavision pour ce projet ?
PML : Ce qui nous a amené à travailler avec Panavision sur ce projet, ce sont les désirs tous concordants de différentes personnes. D’une part, je connais Alexis Petkovsek depuis longtemps, du temps des courts métrages, et je l’apprécie beaucoup. J’avais tourné l’année précédente le long métrage Les Survivants, et la collaboration avec Alexis et Panavision avait été super, pour un film très exigeant tourné dans les conditions difficiles de la montagne et de la neige. Je savais que j’aurais son oreille bienveillante dans le cadre d’un projet au budget très serré, pour lequel je voulais néanmoins garder des ambitions esthétiques fortes. La directrice de production, Louise Krieger - je profite de l’occasion pour saluer son travail remarquable, car il n’était pas évident de parvenir à satisfaire tout le monde, ce qui finalement a été le cas - entretient une relation professionnelle forte et de confiance avec Nicolas Bouchard.
Enfin, la société de production Kazak et son producteur Jean-Christophe Reymond travaillent de longue date avec Panavision. C’est l’ensemble de ces fidélités qui a permis que le film garde toute son ambition, malgré de fortes contraintes budgétaires, toutes les parties ayant vraiment à cœur que le projet se fasse au mieux. Des efforts de compréhension et de flexibilité ont été faits par chacune et chacun pour entendre les raisons et les limites de l’autre. Finalement, j’ai été un directeur de la photo heureux, grâce à toutes ces personnes, et le film garde ses ambitions cinématographiques initiales.
Parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a poussé à devenir directeur de la photographie…
PML : J’ai su assez tôt que je voulais travailler dans le cinéma, j’ai donc suivi un parcours scolaire de type section et bac CAV au lycée, puis DEUG (à Paris III), et enfin la section Image à La Fémis, dont je suis sorti diplômé en 2005. De ce parcours, qui court de l’adolescence jusqu’aux premiers temps de l’âge adulte, je crois que la constante a été une réflexion toujours plus approfondie sur le découpage. L’envie de comprendre ce qui faisait (ou non) la cohérence, la justesse et la force d’une mise en scène, et ce quelle qu’elle soit, que ce soit Nanni Moretti ou John MacTiernan. C’est à La Fémis que j’ai fait mes premiers apprentissages purement techniques, théoriques et pratiques. Je garde un souvenir fort de certains chefs opérateurs qui m’ont marqué par leur façon de travailler ou d’envisager l’image : je pense à des gens comme Bruno Nuytten, Yorgos Arvanitis, AFC, GSC, Ricardo Aronovich, AFC, ADF, et son zone-system, ou encore Pierre Lhomme, AFC. Mais j’étais encore jeune et j’avais du mal à me définir, ce qui fait que La Fémis a aussi joué un rôle ambivalent dans mon parcours : elle m’a un peu dégoûté du cinéma et donc éloigné de la fiction.
Un certain cinéma aux postures agaçantes, souvent abscons, et un peu "bourgeois", des films sans dramaturgie, et hors-sol, m’ont donné une vision un peu restreinte, étriquée et sans doute fausse de ce que pouvait être nos métiers. Je me suis dit, à cette époque, que ce ne serait pas sur les plateaux de fiction que je vivrais des émotions fortes, que je vivrais des expériences qui me feraient grandir en tant qu’homme, que je trouverais une certaine adrénaline, bref que je ferais mon apprentissage du monde. Et comme j’ai toujours aimé la dimension purement physique du cadre, que je suis quelqu’un d’assez actif et que je suis, par ailleurs, aussi passionné de documentaire, je me suis orienté résolument dans la voie de cette pratique en sortant de l’école.
C’était autant une adhésion et un besoin du réel qu’une réaction a une certaine fiction, un certain cinéma français aux postures "intellos" mais finalement pas si intelligentes que ça. Là, s’est ouverte la partie de ma carrière presque exclusivement consacrée au documentaire. J’y ai vu des choses, et vécu des émotions très fortes ; en fait j’ai filmé la vie. J’ai fait de nombreux voyages aux quatre coins du monde, en observant et en filmant les paysages, les gens, leur visage et leurs gestes. J’ai scruté le monde pour en tirer des cadres. J’ai filmé la mort, le pouvoir, la violence ou le chagrin, mais aussi assisté à des naissances, eu accès aux intérieurs et à l’intimité de tant de gens, par qui j’ai dû être accepté, moi et ma caméra. Tout cela m’a nourri et fait grandir. Mais je gardais toujours en moi ce goût pour la fiction et une appétence pour la technique, j’ai eu envie de revenir vers la pensée du découpage, la réflexion sur la mise en scène, les outils et les process propres à l’image en fiction.
Mon ami et désormais illustre chef opérateur Julien Poupard, AFC (nous nous sommes rencontrés à La Fémis) m’a toujours encouragé à revenir à la fiction et à y faire ce que je devais, selon lui, y faire : mettre mes aptitudes - mon regard, mon cerveau et mon corps - au service de réalisatrices et de réalisateurs et de leurs projets de film. J’ai l’impression que c’est un peu grâce à lui que je suis revenu vers la fiction. Malgré ma bascule dans le documentaire, il m’a toujours témoigné une grande confiance, en m’appelant comme cadreur, depuis ses premiers long métrages jusqu’à aujourd’hui. Nous avons travaillé ensemble (moi comme cadreur ou chef op’ deuxième équipe) avec divers réalisateurs comme Ladj Ly (sur Les Misérables ou sur Bâtiment 5, qui sort en décembre prochain), Roschdy Zem, Claire Burger ou encore Houda Benyamina. Je profite de cet entretien pour lui rendre un vibrant hommage et le remercier pour sa confiance depuis toujours. Voilà donc quelques années que je suis revenu vers la fiction, travaillant comme chef opérateur (Trop d’amour, de Frankie Wallach, produit par Agat Films, Les Survivants de Guillaume Renusson, et Anti-Squat), mais aussi comme cadreur ou chef op’ deuxième équipe (entre autres, Les Misérables, Bâtiment 5, de Ladj Ly donc, Mektoub, My Move, d’Abdellatif Kechiche, Quand tu seras grand, d’Andréa Bescond et Eric Métayer, Reste un peu, de Gad Elmaleh, ou Les Miens, de Roschdy Zem).
Qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui ?
PML : Maintenant, j’aspire à poursuivre sur cette voie, en me mettant au service de réalisatrices et de réalisateurs en tant que directeur de la photographie. Rencontrer de nouvelles personnes, plonger dans leur univers, les aider comme collaborateur artistique et technique dans leurs aventures, à chaque fois singulières, envisager différentes approches esthétiques, embrasser différents systèmes de mise en scène. En bref, participer d’un cinéma qui parle du monde et au monde, engagé et engageant. Mais j’aimerais également continuer à jouer de mon parcours et de mon profil, quelque peu pluriel et protéiforme, en me mettant en tant que cadreur au service et sous la direction d’autres chefs opérateurs, j’aime vraiment beaucoup cette position. Ou bien encore, en me mettant au service de réalisateurs sur des projets documentaires. J’aimerais pouvoir continuer à tourner et de la fiction et du documentaire (d’ailleurs je reviens de plusieurs semaines passées en RDC pour un film qui sortira en salles l’année prochaine).
Un dernier mot à ajouter ?
PML : Pour conclure cet entretien, à propos de la sortie d’Anti-Squat, je voudrais réitérer mes remerciements à quelques personnes, pour ce qu’elles m’ont apporté sur ce projet, par leur grande compétence et leur bonne énergie. Tout d’abord je veux remercier Nicolas Silhol, pour son envie et sa confiance, pour cette collaboration idyllique qui a été la nôtre. Et puis avoir un mot pour mon équipe : à mon assistant opérateur, Raphaël Palin Saint-Agathe (qui est vraiment l’assistant dont rêve tout chef op’), à Baptiste Brousse, le chef électricien qui a fait un super travail sur ce projet, et qui s’est donné à fond, à Elie Akoka, l’étalonneur dont la précision de l’œil et la vitesse dans le travail ont été des atouts plus que précieux. Nous avions déjà travaillé sur deux films ensemble, et cela a été chaque fois une collaboration géniale. En étalonnage je suis sur son dos à pinailler sur des détails mais son exigence est telle qu’il pousse les curseurs encore plus loin. A Thibault Carterot et son labo M141 qui, comme toujours, ont amené un service d’une très grande qualité dans un super état d’esprit. Et, enfin, je tiens à remercier Panavision Paris, pour son soutien au film.
 En
En Fr
Fr