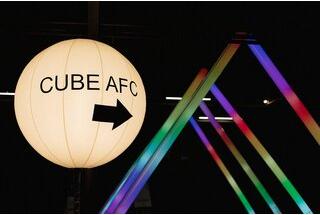par Jeanne Labrune
Notre ami André Neau est mort et j’éprouve, comme tous ceux qui l’ont connu, estimé, aimé, beaucoup beaucoup de peine.
Nous nous étions rencontrés en 1975 pour mon premier long métrage et en quelques jours, grâce à quelques regards posés en commun sur des visages, des corps, des objets dont la nature semblait varier avec les variations de la lumière naturelle, nous avions établi une complicité qui a duré près de vingt-cinq ans et qui, d’années en années, avait de moins en moins besoin de mots.
C’est l’extrême sensibilité d’André et sa grande discrétion qui, dès nos premières séances de travail, m’avaient conquise.
Il s’arrêtait devant les choses et les êtres, les regardait, toujours un peu émerveillé et s’émerveillait de ce que la lumière révélait d’eux. Bien souvent, dans un café, dans un bureau, nos regards convergeaient en même temps vers un visage. Eclairé d’une lumière douce par le soleil se réfléchissant sur un mur blanc, il nous avait paru plein de rondeur et de douceur, puis, le soleil ayant disparu, les lampes du café l’avaient marqué d’un peu de jaune et de rouge, lui donnant un air plus jovial, mais aussi plus trivial et puis le soleil revenant en direct latéralement, ce même visage, tout à coup sculpté au burin, révélait des aspérités, des rudesses et des traits de caractère qui ne cessaient de nous interroger.
Souvent, nous nous regardions après avoir dégusté ensemble ce cheminement de la lumière sur un acteur ou une actrice qui se préoccupait de me séduire par son allure, sa conviction, sa beauté, mais n’imaginait pas ce que la lumière nous révélait d’elle ou de lui, bien au-delà de ce que son discours ou ses gestes produisaient. André et moi, nous nous regardions donc à un moment donné et cela voulait dire : voilà, souvenons-nous de ce type de lumière, non pour la reproduire mais pour l’interpréter.
Ainsi des paysages et des objets. Je lui donnais une reproduction de tableau, je ne lui disais rien, il me disait : « Oui, voilà, tu penses à ça pour la séquence des enfants sur les murs de brique ». Oui, je pensais à cela précisément et pourtant, dans ce tableau que je lui montrais, il n’y avait ni enfant, ni mur de brique. Notre complicité à travers la lumière était simple et évidente, je ne m’en étonnais pas puisque je travaillais toujours avec lui.
Il m’aura fallu, en 1998, travailler sans lui, pour découvrir, non sans douleur, qu’une telle complicité était un trésor. Nous avons traversé ensemble de si nombreux paysages, à de si nombreuses heures, regardé tant de visages, manié tant d’objets dont la couleur changeante nous fascinait, pris entre nos mains, quand nous étions seuls dans les décors, tant de projecteurs que nous faisions tourner autour des choses, la nuit, dans de basses lumières, dans des décors inachevés, que la lumière était devenue comme un trait entre nous. "L’Eloge de l’ombre" de Tanizaki se glissait souvent dans nos pensées. Nous n’en parlions pas, nous le savions. On disait simplement : « L’ombre »... et c’était tout.
André était un homme contemplatif jusqu’à l’oubli du temps, doux et sensuel jusqu’à se laisser envahir, absorber jusqu’à l’oubli de soi et secret : parfois, je l’observais, perdu dans ses sensations et ses pensées et j’avais le sentiment qu’il oubliait tout, jusqu’à ma présence et ce film que nous devions faire. Sur le premier film, j’en avais été parfois étonnée, presque inquiète, et puis j’avais appris avec lui à lâcher prise.
Nous étions là, assis sur une dune de l’Atlantique, dans un paysage absolument obscur, à regarder en silence le faisceau d’un phare sur le rivage et sur ses vagues, nous étions dans un décor de gare abandonnée, à minuit, un soir sans tournage, avec une torche électrique que nous laissions loin de nous dans un coin du décor et nous regardions la nuit, les trains éclairés de l’intérieur, qui projetaient leur lumière sur notre obscurité. Nous ne disions rien. Le temps passait, nous tirions une lampe d’une panière d’accessoires. Je la mettais dans un coin, André riait. Il me disait : « Et puis ? ». Alors j’en mettais une autre ailleurs. Je lui disais : « Voilà, en gros, ce que feront les acteurs, dans quelle aire je les vois se déplacer ». Il hochait la tête et riait. Je savais alors que je le piégeais. Il commençait à tourner en rond dans le décor, auscultait tout et puis se rasseyait et disait : « Bon ».
Il y avait en lui l’incroyable poésie des gens forts de leur expérience et de leur sensibilité qui acceptent avec curiosité et calme de prendre des risques majeurs et qui n’ont pas cette insupportable faiblesse de vouloir s’imposer par l’obstruction, les théories, la prise en main ostentatoire du plateau. Il était avec ses assistants, avec toute son équipe, comme il était avec moi, léger, silencieux, rêveur et amical.
Dans les circonstances les plus difficiles, celles où le temps manquait, celles où les acteurs étaient tendus, fatigués, il était toujours plus soucieux du film que du plan.
Souvent d’un regard ou d’un mot, nous décidions ensemble de prendre un risque majeur. Eclairer vite, très vite, un plan, pour garder la tension du tournage et l’attention à ce que je voulais obtenir des acteurs, ou bien, très vite il venait me chercher et me montrait qu’au-dehors le ciel allait nous offrir une lumière inespérée et m’indiquait que c’était à moi de décider si je voulais interrompre le tournage avec les acteurs pour aller au-dehors, tourner un plan qui n’était pas prévu mais qui était un don. Personne dans l’équipe, hormis mes assistants et les siens, n’était témoin de cet échange, cela se faisait sans bruit, sans démonstration, sans tension.
Souvent mon assistant ou moi nous cherchions André dans les décors, on le trouvait assis dans un coin, rêveur et nous lui demandions : « Alors, André ? ». Il nous disait, étonné : « C’est prêt... Mais vous étiez en train de parler... »
Et puis, certaine nuit de notre dernier tournage, Nathalie Baye, à deux heures du matin, à une terrasse de café, en face de Daniel Duval, devait porter des lunettes noires, très sombres, pour dissimuler des yeux rougis par les larmes.
André s’approcha d’elle, vint près de moi et de la caméra. Il ne fallait aucun reflet dans ces verres noirs, ni de la rue, ni du café, ni des projecteurs, bien entendu : deux écrans noirs, opaques, comme deux immenses yeux perdus, éblouis d’obscurité et pourtant il fallait aussi que Nathalie soit belle, lumineuse et comme transfigurée par sa douloureuse passion. Alors André sourit.
Nathalie nous dit : « Je peux me dévisser un peu par là si vous voulez... ».
André lui dit : « Non, c’est très bien ».
Je voyais dans les lunettes mille reflets, le café, les réverbères, les projecteurs, j’allai voir Daniel et Nathalie, je leur dis trois mots, André me tapa doucement dans le dos. Je me redressai, je retournai à la caméra que je venais de quitter. Les lunettes étaient noires, absolument noires, et Nathalie était lumineuse et douce.
André travaillait dans le respect. Respect du film, des acteurs et respect du monde. Il percevait la lumière comme un cadeau que le monde lui offrait, il ne lui serait jamais venu à l’idée que sa lumière était un cadeau qu’il nous offrait. Il était rare car il était d’une élégance extrême.
Jacqueline, sa femme, va faire planter un arbre là où il est désormais. Cet arbre, c’est lui, dans cette solidité qu’il avait au fond de lui-même mais qui toujours se nimbait de douceur et de frissons, savait capter la lumière et jouer avec ses nuances, comme les feuillages sous le soleil et dans le vent dont on regarde avec étonnement la grâce vivante. André, en quittant notre monde est retourné au monde, il a regagné le paysage et la lumière. Je pense à lui, le soir, quand j’allume mes lampes dont le jaune fait bleuir davantage encore le crépuscule de la rue et je pense à lui chaque fois que le soleil se glisse entre les nuages.
Et puis je sais qu’il est là, dans les films que nous avons faits ensemble en partageant la même passion.
Salut André et merci, infiniment.
 En
En Fr
Fr